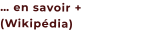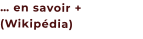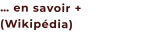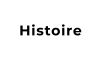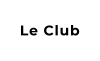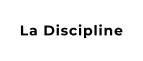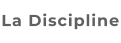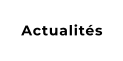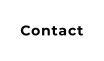Le kendo (littéralement « la voie du sabre ») est la version moderne du kenjutsu
( techniques du sabre), l'escrime au sabre pratiquée autrefois au Japon par les
samouraïs. Par version moderne, il faut comprendre que le kendo n'est pas
seulement un art martial mais également un sport de compétition, aujourd'hui
largement pratiqué au Japon.
Le kendo ne se résume toutefois pas à un simple ensemble de techniques et de
tactiques du combat au sabre. Il comprend également un volet spirituel. Le
kendo permet à ses pratiquants de développer leur force de caractère et leur
détermination.
Après une longue période de guerres et l'unification du pays par le shogun
Tokugawa Ieyasu, le Japon entre dans une ère de paix qui durera plus de 260
ans, l'époque d'Edo (1600-1868), au cours de laquelle l'escrime au sabre, le
kenjutsu, qui a perdu sa finalité sur les champs de bataille, continue à être
enseignée dans le cadre de la formation de la caste dirigeante, celle des bushi
(ou samouraï) : le kenjutsu est l'un des dix-huit arts martiaux que doit pratiquer
le bushi. De nombreux traités sur le sabre sont publiés à cette époque au Japon
tel le Gorin no shō de Miyamoto Musashi ou le Hagakure de Yamamoto Jocho.
De « sabre pour tuer » (setsuninto), le kenjutsu évolue vers « sabre pour vivre »
(katsuninken) par l'étude duquel le pratiquant forge sa personnalité. Afin de
faciliter la pratique jusque-là limitée à des katas au sabre de bois (bokken) ou au
sabre réel, Naganuma Shiro développe au début du XVIIIe siècle le sabre en
bambou (shinai) et différentes protections (bogu) afin d'autoriser des frappes
réelles pendant les assauts. Parallèlement à l'amélioration du matériel qui prend
la forme définitive que nous lui connaissons aujourd'hui peu avant la fin de l'ère
Edo, le kenjutsu évolue vers sa forme moderne, le kendo.
À la Restauration de Meiji (1868), le port du sabre est interdit par décret impérial
en 1876, la classe des samouraïs est dissoute et les arts martiaux tombent en
désuétude avec l'introduction des techniques militaires occidentales. Les arts
martiaux, dont le kenjutsu, renaissent toutefois dès 1878 dans les écoles de
police et la première fédération d'arts martiaux, la Nihon Butokukai est créée à
Kyōto au sein du dojo Butokuden en 1895. Jusque-là appelé kenjutsu, c'est en
1912 qu'il est fait pour la première fois mention du kendo dans la publication
des Nihon Kendo no Kata (Kata pour le kendo). L'Occident découvre le kendo dès
le XIXe siècle à travers des récits de voyages mais ce n'est qu'en 1899 qu'a lieu la
première démonstration de kendo en France à l'occasion de la visite du créateur
du judo moderne, Jigoro Kano.
La défaite du Japon en 1945 porte un coup sévère aux arts martiaux japonais en
général et au kendo en particulier, responsables selon l'occupant Américain de
véhiculer une idéologie militariste via le bushido. Le kendo sera ainsi interdit
après la guerre, mais sa pratique sportive se poursuivra sous le nom de «
compétition au shinai » jusqu'en 1952 date à laquelle se constitue la Fédération
Japonaise de Kendo (Zen Nippon Kendo Renmei). À cette occasion, des maîtres
sont dépêchés à l'étranger.
LE BUDÖ
Les budō (武道?) sont les arts martiaux japonais apparus entre le milieu du XIXe
siècle et le milieu du XXe siècle. En japonais, bu (武?) signifie « guerre » et dō (道?)
signifie « voie » (en chinois : dao ou tao, cf. le taoïsme). Les budō les plus connus
en Occident sont le karaté-do, le judo, l’aïkido et le kendo. Ce sont les héritiers
des techniques guerrières médiévales, les bujutsu (c'est-à-dire le jūjutsu,
l'aikijūjutsu, le kenjutsu, etc.). Le pratiquant d'un budō est appelé Budoka.
Le kanji bu désigne la guerre, le kanji dō désigne la voie. Le terme kanji dō,
utilisé pour designer la voie, s'oppose à celui de kanji jutsu du bujutsu et a pour
but de distinguer les anciens arts de guerre des nouveaux arts éducatifs.
Si le terme budō apparaît exceptionnellement dans certains écrits antérieur à
l'ère Meiji (1868-1912), souvent dans le sens de bushidō, c'est à cette époque
que le terme prend le sens qu'on lui connait aujourd'hui1.
On peut attribuer le terme à Jigorō Kanō, fondateur du Judo, le premier des
budō. En effet, le travail de Kano consista d'une part à combiner et codifier
d'anciennes techniques de jūjutsu en un tout cohérent conçu pour l'éducation
scolaire, et d'autre part à faire accepter l'introduction des arts martiaux dans le
cursus scolaire aux officiels de l'époque. La mauvaise image du jūjutsu, lié à la
période pré-Meiji de conflits continus entre samouraï traditionalistes et
progressistes et ayant mené nombre d'anciens samouraïs à la délinquance,
aurait poussé Kano à renommer son art Judo, ou Kodokan Judo pour être précis,
plutôt que jujutsu. C'est dans cet esprit que certains arts se verrons
temporairement renommés en « dō » avant que celui-ci disparaisse à nouveau
comme le sumo-do ou le naginata-do.
Kano fut fortement influencé par l'idéologie de Herbert Spencer, et à une
époque ou le Japon faisait de grands efforts de modernisation par l'introduction
massive des idéologies et technologies occidentales, il est raisonnable de penser
que la dimension éducative des budō a été fortement influencée par la pensée
occidentale de la fin du XIXe siècle. Le choix du kanji (la voie) pour remplacer le
kanji (la technique) s'inscrit dans cette démarche d'évolution de techniques de
guerre vers des méthodes éducatives.
S'en suivra un mouvement de normalisation des pratiques martiales durant la
première moitié du XXe siècle ou de nombreux arts martiaux se verront
renommés et intégrés à une liste "officielle" liée au gouvernement, à la Dai
Nippon Butokukai, puis de nos jours à l'association du Nippon Budōkan. Les 9
budō officiel aujourd'hui sont: le judo, le karatedo, le kendo, le sumo, le kyudo,
l'aikido, le shorinji kempo, le naginata et le jukendo.
D'autres arts sont considérés de manière populaire comme des budō : le iaido ou
le nippon kempo, bien qu'ils ne soient pas reconnus comme tel par l'association
du Nippon Budokan (les différentes écoles d'Iaido sont généralement considérées
comme des kobudō, budō anciens).




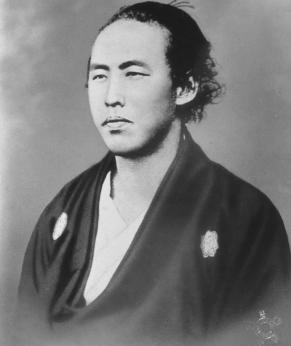
Samouraïs de légende
MIYAMOTO MUSASHI
(1584-1645)
«On gagne une bataille
en connaissant le
rythme de l'ennemi, et
en utilisant un rythme
auquel il ne s'attendait
pas».
HATTORI HANZō (1542-
1597)
SAKAMOTO RYOMA
ODA NOBUNAGAS
KATSU KAISHUS

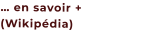




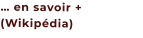
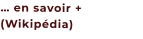
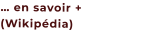
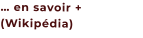
HISTOIRE
(source Wikipedia)
Le Code du Bushido
Qu’est que le Bushido des Samouraï ?
Dans son ouvrage « Bushido : l’Ame du Japon » écrit en 1900,
Izano Nitobe (1862-1933), professeur à l’Université Impériale du
Japon et membre de l’Académie Impériale, le fait découvrir au
monde. Le bushido peut être traduit comme suit :
Le préfixe bu signifie « l'ensemble des techniques martiales » en
japonais. Shi signifie « guerrier », et le suffixe do désigne la «
voie ».
Le Bushido est donc le code d'honneur de la caste militaire
japonaise (samouraï) qui dirigeait leur vie.
Il se compose de 7 principes :
- Gi : sens du devoir (parfois aussi traduit par "rectitude" ou
"rigueur")
- Yu : courage
- Jin : bienveillance (parfois aussi traduit par "grandeur d'âme",
"compassion" ou "générosité")
- Rei : politesse
- Makoto : sincérité (ou "honnêteté")
- Meiyo : honneur (au sens de réputation)
- Chugo : loyauté
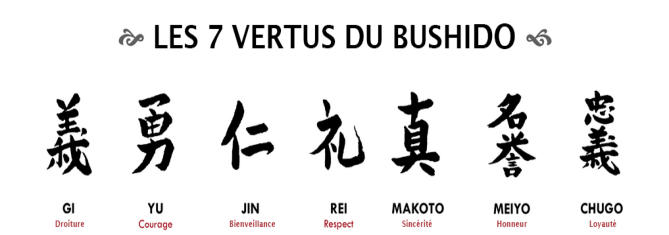
-

ADRESSE
rue des XVIII bonniers
4460 Gràce-Hollogne
designed by DeDecA
CONTACT
E-mail :
jacques.swinnen@hotmail.com
tel:0474.88.33.68

Le kendo (littéralement « la voie du sabre
») est la version moderne du kenjutsu (
techniques du sabre), l'escrime au sabre
pratiquée autrefois au Japon par les
samouraïs. Par version moderne, il faut
comprendre que le kendo n'est pas
seulement un art martial mais également
un sport de compétition, aujourd'hui
largement pratiqué au Japon.
Le kendo ne se résume toutefois pas à un
simple ensemble de techniques et de
tactiques du combat au sabre. Il
comprend également un volet spirituel. Le
kendo permet à ses pratiquants de
développer leur force de caractère et leur
détermination.
Après une longue période de guerres et
l'unification du pays par le shogun
Tokugawa Ieyasu, le Japon entre dans une
ère de paix qui durera plus de 260 ans,
l'époque d'Edo (1600-1868), au cours de
laquelle l'escrime au sabre, le kenjutsu,
qui a perdu sa finalité sur les champs de
bataille, continue à être enseignée dans le
cadre de la formation de la caste
dirigeante, celle des bushi (ou samouraï) :
le kenjutsu est l'un des dix-huit arts
martiaux que doit pratiquer le bushi. De
nombreux traités sur le sabre sont
publiés à cette époque au Japon tel le
Gorin no shō de Miyamoto Musashi ou le
Hagakure de Yamamoto Jocho. De « sabre
pour tuer » (setsuninto), le kenjutsu
évolue vers « sabre pour vivre »
(katsuninken) par l'étude duquel le
pratiquant forge sa personnalité. Afin de
faciliter la pratique jusque-là limitée à des
katas au sabre de bois (bokken) ou au
sabre réel, Naganuma Shiro développe au
début du XVIIIe siècle le sabre en bambou
(shinai) et différentes protections (bogu)
afin d'autoriser des frappes réelles
pendant les assauts. Parallèlement à
l'amélioration du matériel qui prend la
forme définitive que nous lui connaissons
aujourd'hui peu avant la fin de l'ère Edo,
le kenjutsu évolue vers sa forme
moderne, le kendo.
À la Restauration de Meiji (1868), le port
du sabre est interdit par décret impérial
en 1876, la classe des samouraïs est
dissoute et les arts martiaux tombent en
désuétude avec l'introduction des
techniques militaires occidentales. Les
arts martiaux, dont le kenjutsu, renaissent
toutefois dès 1878 dans les écoles de
police et la première fédération d'arts
martiaux, la Nihon Butokukai est créée à
Kyōto au sein du dojo Butokuden en
1895. Jusque-là appelé kenjutsu, c'est en
1912 qu'il est fait pour la première fois
mention du kendo dans la publication des
Nihon Kendo no Kata (Kata pour le
kendo). L'Occident découvre le kendo dès
le XIXe siècle à travers des récits de
voyages mais ce n'est qu'en 1899 qu'a lieu
la première démonstration de kendo en
France à l'occasion de la visite du créateur
du judo moderne, Jigoro Kano.
La défaite du Japon en 1945 porte un
coup sévère aux arts martiaux japonais
en général et au kendo en particulier,
responsables selon l'occupant Américain
de véhiculer une idéologie militariste via
le bushido. Le kendo sera ainsi interdit
après la guerre, mais sa pratique sportive
se poursuivra sous le nom de «
compétition au shinai » jusqu'en 1952
date à laquelle se constitue la Fédération
Japonaise de Kendo (Zen Nippon Kendo
Renmei). À cette occasion, des maîtres
sont dépêchés à l'étranger.
LE BUDÖ
Les budō (武道?) sont les arts martiaux
japonais apparus entre le milieu du XIXe
siècle et le milieu du XXe siècle. En
japonais, bu (武?) signifie « guerre » et dō (
道?) signifie « voie » (en chinois : dao ou
tao, cf. le taoïsme). Les budō les plus
connus en Occident sont le karaté-do, le
judo, l’aïkido et le kendo. Ce sont les
héritiers des techniques guerrières
médiévales, les bujutsu (c'est-à-dire le
jūjutsu, l'aikijūjutsu, le kenjutsu, etc.). Le
pratiquant d'un budō est appelé Budoka.
Le kanji bu désigne la guerre, le kanji dō
désigne la voie. Le terme kanji dō, utilisé
pour designer la voie, s'oppose à celui de
kanji jutsu du bujutsu et a pour but de
distinguer les anciens arts de guerre des
nouveaux arts éducatifs.
Si le terme budō apparaît
exceptionnellement dans certains écrits
antérieur à l'ère Meiji (1868-1912),
souvent dans le sens de bushidō, c'est à
cette époque que le terme prend le sens
qu'on lui connait aujourd'hui1.
On peut attribuer le terme à Jigorō Kanō,
fondateur du Judo, le premier des budō.
En effet, le travail de Kano consista d'une
part à combiner et codifier d'anciennes
techniques de jūjutsu en un tout cohérent
conçu pour l'éducation scolaire, et d'autre
part à faire accepter l'introduction des
arts martiaux dans le cursus scolaire aux
officiels de l'époque. La mauvaise image
du jūjutsu, lié à la période pré-Meiji de
conflits continus entre samouraï
traditionalistes et progressistes et ayant
mené nombre d'anciens samouraïs à la
délinquance, aurait poussé Kano à
renommer son art Judo, ou Kodokan Judo
pour être précis, plutôt que jujutsu. C'est
dans cet esprit que certains arts se
verrons temporairement renommés en «
dō » avant que celui-ci disparaisse à
nouveau comme le sumo-do ou le
naginata-do.
Kano fut fortement influencé par
l'idéologie de Herbert Spencer, et à une
époque ou le Japon faisait de grands
efforts de modernisation par
l'introduction massive des idéologies et
technologies occidentales, il est
raisonnable de penser que la dimension
éducative des budō a été fortement
influencée par la pensée occidentale de la
fin du XIXe siècle. Le choix du kanji (la
voie) pour remplacer le kanji (la
technique) s'inscrit dans cette démarche
d'évolution de techniques de guerre vers
des méthodes éducatives.
S'en suivra un mouvement de
normalisation des pratiques martiales
durant la première moitié du XXe siècle
ou de nombreux arts martiaux se verront
renommés et intégrés à une liste
"officielle" liée au gouvernement, à la Dai
Nippon Butokukai, puis de nos jours à
l'association du Nippon Budōkan. Les 9
budō officiel aujourd'hui sont: le judo, le
karatedo, le kendo, le sumo, le kyudo,
l'aikido, le shorinji kempo, le naginata
et le jukendo.
D'autres arts sont considérés de manière
populaire comme des budō : le iaido ou le
nippon kempo, bien qu'ils ne soient pas
reconnus comme tel par l'association du
Nippon Budokan (les différentes écoles
d'Iaido sont généralement considérées
comme des kobudō, budō anciens).
Le Code du Bushido
Qu’est que le Bushido des Samouraï ?
Dans son ouvrage « Bushido : l’Ame du Japon » écrit en
1900, Izano Nitobe (1862-1933), professeur à
l’Université Impériale du Japon et membre de
l’Académie Impériale, le fait découvrir au monde. Le
bushido peut être traduit comme suit :
Le préfixe bu signifie « l'ensemble des techniques
martiales » en japonais. Shi signifie « guerrier », et le
suffixe do désigne la « voie ».
Le Bushido est donc le code d'honneur de la caste
militaire japonaise (samouraï) qui dirigeait leur vie.
Il se compose de 7 principes :
- Gi : sens du devoir (parfois aussi traduit par
"rectitude" ou "rigueur")
- Yu : courage
- Jin : bienveillance (parfois aussi traduit par "grandeur
d'âme", "compassion" ou "générosité")
- Rei : politesse
- Makoto : sincérité (ou "honnêteté")
- Meiyo : honneur (au sens de réputation)
- Chugo : loyauté
HISTOIRE
(source Wikipedia)
Samouraïs de légende

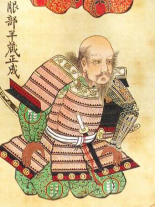



MIYAMOTO MUSASHI
(1584-1645)
«On gagne une bataille
en connaissant le
rythme de l'ennemi, et
en utilisant un rythme
auquel il ne s'attendait
pas».
HATTORI HANZō (1542-
1597)
KATSU KAISHUS
ODA NOBUNAGAS
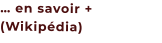
SAKAMOTO RYOMA